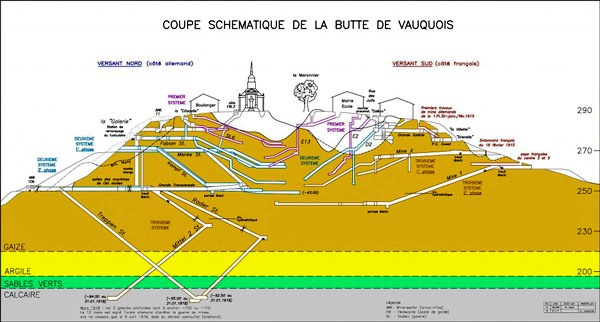143ème
semaine
Du
lundi 22 au dimanche 28 avril 1917
BRAVOURES
INDIVIDUELLES DANS UN DÉSASTRE COLLECTIF
Jean-Aimé Benoit, soldat au 31e
régiment d’infanterie
Disparu
le 16 avril 1917 au Bois-des-Buttes (Aisne)
Jean-Aimé Benoit est né à la Grand-Combe le 19
juin 1894, de Jean et d’Augustine née Borne. En 1914 il habite à Anduze, où il
exerce la profession de journalier. Ayant tout juste 20 ans à la déclaration de
guerre, il est aussitôt incorporé le 6 septembre au 112ème régiment
d’infanterie. Beaucoup d’Anduziens font partie de ce régiment, trois d’entre
eux y laisseront leur vie : Numa-Louis Boudouric (voir semaine 046), Louis Cazenove (voir semaine 086), César-Léon Roux (voir semaine 100). Il y reste jusqu’au 5 mars 1915, il est alors
affecté au 31ème régiment d’infanterie. Il y retrouve au moins un autre
Anduzien, Henri-Félix Bastide, tué cinq mois plus tard à Vauquois (voir semaine 054).
En mars 1915, le 31 RI est en plein
dans la terrible lutte qui oppose les belligérants pour la possession de la
colline de Vauquois. Efficacement fortifié par les Allemands, son plateau n’a
pu être repris qu’en partie par les Français. La situation dure de longs mois,
marqués par des combats au lance-flamme et des explosions de mines énormes. On
note en particulier que le 23 mars 1916 le génie français fit sauter une mine
de 12 tonnes d’explosifs. Mais le cratère de 50 mètres de diamètre entama aussi
bien les lignes françaises qu’allemandes, et dans la confusion qui s’ensuivit
les troupes ennemies occupèrent chacune l’une des lèvres de l’entonnoir.
Le 31 RI est l’un des rares
régiments français à n’avoir pas combattu à Verdun. Entre septembre et novembre
1916, il participe aux batailles de la Somme. De nombreux faits héroïques sont
rapportés par l’historique de ce régiment pour cette période, on en retiendra
un : « La mort glorieuse du sous-lieutenant Charpentier, de la 11e
compagnie, pendant la contre-attaque du 20 septembre, mérite une mention
spéciale. Ce tout jeune officier de 20 ans à peine, depuis le début des combats
de la Somme, se dépense sans compter ; infatigable, insouciant du danger,
joyeux, il donne le plus bel exemple d'héroïsme. Le 20 septembre, à 7 heures, Charpentier
qui, narguant la mort, s'est porté en avant pour voir, dit-il, arriver ces
messieurs, s'écrie : « Les voilà qui
montent. » Il revient au milieu de ses hommes pour ne pas gêner leur tir et
tombe bientôt touché à la gorge par un éclat d'obus. Le sang gicle, arrosant
les hommes qui veulent lui porter secours ; lui-même comprime sa blessure avec
ses doigts et pose son pansement en murmurant : « Carotide tranchée, allons, suis fichu ! », puis, aux
soldats qui l'entouraient : « Vous
autres, allez vous battre, il y a assez de besogne en ce moment. » En
effet, les vagues d'assaut ennemies se succèdent sans interruption ; chaque
fois anéanties et chaque fois remplacées. Charpentier, étendu au fond de la
tranchée, demande à chaque instant : « Eh
bien ! Comment ça va ? » et son visage s'illumine en apprenant les pertes
énormes subies par l'ennemi. Mais le sang continue à couler, le blessé
s'affaiblit ; le lieutenant Rouleau, commandant la compagnie, sur les instances
de ses hommes, parle de transporter Charpentier au poste de secours, mais le
brave officier s'y refuse net, ajoutant d'un ton de reproche : « Oh ! Mon lieutenant, sacrifier ces hommes
dont vous avez tant besoin, le feriez-vous pour vous ? » Jusqu'à midi, Charpentier
encourage ses hommes, il a l'air de ne pas souffrir. « Ma blessure est légère,
dit-il, qu'ils ne s'en inquiètent pas », et, pourtant, quelques instants après,
seul avec son lieutenant, il lui confie ses dernières pensées : « Oh ! Mon lieutenant ! C’est dur tout de même
de mourir à 20 ans, et surtout de se voir mourir ! » Il repense ensuite à
ses hommes : « Embrassez-moi pour eux,
voulez-vous ? » ; Après quoi il ajoute : « Je suis heureux, nous avons tenu et je suis vengé. » Sa mort, vers
13 heures, coïncide avec le ralentissement des attaques sur le front de la compagnie ».
Suite de l’historique de ce
régiment pour avril 1917 :
« Après quelques jours de
repos en Seine-Inférieure et une courte période d'instruction au camp de Mailly,
le régiment est transporté par camions dans le secteur du Chemin-des-Dames
(région d'Ailles), où il séjourne trente-quatre jours.
Il se rend ensuite au camp de
Lhéry (sud de Jonchery) pour une nouvelle période d'instruction. C'est là qu'il
apprend qu'il doit, avec le 5e C. A., participer à l'offensive du 16 avril 1917
et que le secteur du bois des Buttes lui est affecté.
Enfoncé dans nos lignes comme un énorme
bastion, le bois des Buttes domine tout le pays de Craonne à Berry-au-Bac. Sa
puissance défensive est considérable. Il constitue une véritable forteresse,
prenant d'enfilade les lignes françaises. Sur les sommets, sont installés de
nombreux observatoires à l'épreuve, dont les vues s'étendent au loin derrière
notre tête de pont en avant de l'Aisne.
Du 5 février au 2 avril, le 31e
occupe le sous-secteur des Buttes, période rendue pénible par sa longueur,
l'agitation grandissante et les réactions de plus en plus violentes de
l'ennemi, mais pendant laquelle s'effectue le travail lent, minutieux et
compliqué de la préparation de l'attaque. Le 2 avril, le régiment est relevé et
se rend aux carrières de Roucy pour parachever l'instruction des spécialistes
et arrêter les derniers détails du plan d'attaque. Les 11 et 12 avril, le
régiment remonte en ligne, tandis que se poursuit, pendant plusieurs jours, puissante
et méthodique, la préparation d'artillerie. Dans la nuit du 15 au 16 avril, nos
patrouilles pénètrent jusqu'à la deuxième ligne, où l'ennemi s'est retiré.
 |
| Attaque du Bois des Buttes par le 31 RI le 16 avril 1917 |
L'attaque est fixée pour le 16
avril, 5 h.50.
A droite : le commandant Lagorce,
avec le 1er bataillon et la 7e compagnie, attaque du sud au nord, avec
objectifs la cote 96, la lisière sud de la Ville-au-Bois.
A gauche : le commandant Fleuriot,
avec le 3e bataillon, attaque de l'ouest à l'est avec objectifs la
Ville-au-Bois.
Le commandant Holtzscherer se tient
en réserve, avec les 5e et 6e compagnies, à la Sapinière.
Les unités d'assaut quittent les
parallèles de départ de dix à quinze minutes avant l'heure H pour se glisser
par petits paquets jusqu'à la première ligne ennemie ; là, tapies au fond des entonnoirs,
elles attendent le signal de l'attaque.
A 5 h.30, l'attaque se déclenche ;
à 6 h.15, le combat commence, l'ennemi s'est ressaisi et se défend sur sa
troisième ligne. Tout de suite, le combat se morcèle, l'action d'ensemble
disparaît pour faire place aux initiatives individuelles. Partout la lutte est
menée avec un courage et une abnégation qui coûtent la vie à beaucoup.
Le 16 au soir, le régiment occupe
presque tous ses objectifs : le bois des Buttes est pris en entier, la Ville-aux-Bois
résiste encore, mais ce village est aux trois quarts encerclé.
Parmi les nombreux actes
d'héroïsme accomplis dans cette journée glorieuse pour le 31e, nous ne mentionnerons
que les épisodes suivants :
Le capitaine Paillard, communément
appelé un « as » par ses poilus, qui a donné la mesure de son courage comme
sous-lieutenant bombardier à Vauquois, est chargé d'enlever, avec la 7e compagnie,
le « Nez-du-Boche » et la cote 92. Il part à l'assaut en tête de sa compagnie, communiquant
à tous sa foi dans le succès. Les premières tranchées boches sont enlevées avec
un entrain irrésistible ; mais, sur les pentes sud de 92, l'ennemi
résiste, ses mitrailleuses se déclenchent, la progression devient lente et
coûteuse. Le capitaine Paillard, bien que blessé grièvement, continue à
combattre. Il est le plus brillant soldat de son unité ; il encourage ses hommes
et ne consent à être emporté, pleurant de rage, qu'après avoir donné ses ordres
pour continuer la progression, le succès lui paraissant assuré.
Section Dubois. — A la cote 92, le
combat est dur, les 3e et 7e compagnies sont arrêtées par un feu terrible de
mitrailleuses devant la troisième ligne dénommée « Tumpling Stellung ».
Envoyée en renfort, la section Dubois réussit, par une manœuvre habile, à
prendre d'écharpe la tranchée ennemie, se dévoile brusquement, et, par un feu
intense, fait une véritable hécatombe de Bavarois. La ligne arrêtée en profite
pour faire un bond en avant et sauter dans la tranchée. La poursuite continue
sur les pentes nord de la butte où l'ennemi s'est creusé de vastes tunnels ; la
lutte est dure à l'entrée de ces abris, elle devient farouche à l'entrée du
principal abri « le Régiments Tunnel », occupé par deux compagnies, et où se
trouve un P. C. de chef de bataillon. Une mitrailleuse en défend l'entrée. Les
Allemands en mettent deux autres en batterie quand survient Dubois avec sa
section. Une lutte à la grenade s'engage, les Allemands se sauvent dans le
Tunnel, poursuivis par les nôtres qui lancent dans l'entrée des grenades
incendiaires. Dubois fait surveiller l'entrée par deux hommes en attendant les
nettoyeurs et poursuit sa marche vers la Ville-aux-Bois. A quelque distance de
là, il trouve un boyau plein d'ennemis. Il s'élance aussitôt, mais le tir d'une
mitrailleuse l'a coupé de sa section : deux hommes seulement le suivent. Sans
hésiter, il engage le combat : d'un coup de revolver il abat le premier
Allemand, tandis que les deux hommes lancent leurs grenades au milieu des
ennemis. Déconcertés, ces derniers mettent bas les armes et défilent devant les
trois Français qui, stupéfaits et vaguement inquiets, comptent jusqu'à 72
prisonniers. Le reste de la section Dubois rejoint à ce moment.
Le soldat Larramendy, qui, en
maintes circonstances, avait donné la mesure de son courage : à Vauquois, en
délogeant à coups de grenades l'ennemi qui avait pris possession d'un
entonnoir, résultat d'une explosion de mine ; à Bouchavesnes, en contribuant au
sauvetage de trois camarades ensevelis et en rapportant dans nos lignes le
corps d'un officier tué, devait encore donner, le 16 avril 1917, de nouvelles
preuves de courage et d'abnégation.
Au cours de l'attaque, un centre de
résistance ennemi, composé de mitrailleuses, empêche la progression du
bataillon Fleuriot. L'agent de liaison Larramendy parvient à se glisser seul
derrière les mitrailleuses ennemies ! Il prévient son commandant de compagnie
qui lui envoie le fusilier-mitrailleur Mormant. Le tir commence, Mormant est
grièvement blessé. Larramendy s'empare de son arme et continue le tir. Les
Allemands sont déconcertés et se rendent à lui : ils sont une cinquantaine. Pendant
ce temps, le 3e bataillon reprend sa progression en avant.
 |
| Aquarelle, 17 avril 1917, annoté: "Sous Craonne, le lendemain de la prise du Bois des Buttes, dessin rehaussé de jus d’huîtres ! faute d'eau". (26x18cm). |
Autour de la Ville-aux-Bois, la
lutte continue âpre et sans trêve pendant la nuit du 16 au 17 et le 17 avril. A
16 heures, le régiment déclenche une attaque contre la Ville-aux-Bois, mais
elle ne peut progresser ; elle est reprise le 18 avril au matin, et réussit
pleinement. Les Allemands, surpris au sortir de leurs sapes, attaqués avec
furie par nos soldats que le succès grise, se rendent par paquets.
Du 19 au 23 avril, le régiment
occupe et organise la position conquise, ayant, grâce aux abris nombreux, peu à
souffrir des violents bombardements ennemis.
Pour tous les actes d'héroïsme
accomplis les 16 et 18 avril et sa belle conduite, le régiment obtient d'être
cité à l'ordre de la Ve armée : « Le
31e régiment d'infanterie, sous le commandement de son chef, le
lieutenant-colonel Cuny, a enlevé très brillamment les 16, 17 et 18 avril 1917,
tous les objectifs qui lui avaient été assignés et, par un combat opiniâtre,
est parvenu à réaliser un gain de terrain de trois kilomètres en profondeur, faisant
à lui seul 1.500 prisonniers, dont 34 officiers, et 170 sous-officiers,
capturant 6 canons, plusieurs minenwerfers, 50 mitrailleuses et un important
matériel de toute nature. Régiment d'élite de la plus haute valeur offensive. Le
Général commandant la Ve armée, Signé : Mazel ».
Un tel historique, mettant en
avant des actes de bravoure individuelle, cache l’essentiel : cette offensive
a été un désastre… Les premiers succès sur le terrain dont s’est targué le
commandement n’était dû en fait qu’au retrait en profondeur des Allemands.
Prévenue par l’exceptionnelle préparation d’artillerie concentrée sur quelques
dizaines de kilomètres et sans doute aussi par quelques informateurs, l’armée allemande
avait pu prendre toutes ses dispositions pour attendre de pied ferme, un peu
plus loin, les troupes françaises épuisées et démoralisées par le feu terrible
d’innombrables mitrailleuses. Et ce n’est pas le limogeage rapide du généralissime
Nivelle, premier responsable de cette catastrophe, qui aura pu consoler les
soldats sacrifiés et leurs familles en deuil.
 Jean-Aimé Benoit fait partie des soldats sacrifiés
dans cette vaine offensive. Il est déclaré sur son registre matricule comme
mort des suites de ses blessures le 16 avril 1917, et sur sa fiche
récapitulative comme tué à l’ennemi le 17 avril 1917. Mais comme son décès n’a
officiellement été enregistré que le 26 août 1921, il faut en conclure qu’il a
vraisemblablement disparu lors des combats de la grande offensive du 16 avril, puis
que ses restes ont été identifiés avant d’être déposés au cimetière de
Pontavert, devenu la Nécropole Nationale de Beaurepaire, où il occupe la tombe
n° 3654. Son nom figure sur le monument aux morts de la commune.
Jean-Aimé Benoit fait partie des soldats sacrifiés
dans cette vaine offensive. Il est déclaré sur son registre matricule comme
mort des suites de ses blessures le 16 avril 1917, et sur sa fiche
récapitulative comme tué à l’ennemi le 17 avril 1917. Mais comme son décès n’a
officiellement été enregistré que le 26 août 1921, il faut en conclure qu’il a
vraisemblablement disparu lors des combats de la grande offensive du 16 avril, puis
que ses restes ont été identifiés avant d’être déposés au cimetière de
Pontavert, devenu la Nécropole Nationale de Beaurepaire, où il occupe la tombe
n° 3654. Son nom figure sur le monument aux morts de la commune.
Fait relativement exceptionnel :
un secours de 150 francs a été accordé à sa famille le 20 novembre 1917, faible
témoignage des difficultés dans lesquelles devaient se débattre des familles
certaines de la mort de leur proche, mais n’ayant aucun document officiel pour
le prouver.
A suivre…